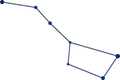
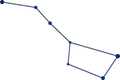








L’été 2017, étant invitée par le Centre culturel Reduta de la ville de Brașov en Roumanie pour la troisième édition de la résidence d’art contemporain, je suis allée dans cette ville inconnue pour créer une œuvre in situ et l’exposer sur place. Comme c’était aussi ma première visite en Roumanie, j’ai pris cette occasion comme une découverte de cette terre dans l’Est de l’Europe, et je suis allée, la tête vide, n’emportant aucune idée préconçue. Dès le premier soir du séjour, depuis la fenêtre de la voiture entrant dans la ville, j’ai été saisie par un panneau illuminé, composé de cinq lettres géantes de « Brașov », sur la montagne sombre derrière la ville nocturne. Elles indiquent fortement une sorte d’identité de cette ville touristique.
J’ai passé les premiers quatre jours à chercher les racines historiques de cette ville, en même temps, mon regard était toujours attiré par le mont Tâmpa couverte d’une forêt dense vert profond, en particulier par le panneau emblématique, omniprésent du paysage de Brașov, qui semblait s’identifier d’une manière renouvelée depuis un passé souffrant. En réalité, par la lecture des archives historiques et à travers les discussions avec les amis locaux, j’ai appris une histoire absurde du mont Tâmpa. Le 19 août 1946, un grand incendie a brûlé une partie considérable de la forêt sur la montagne. Lorsque Braşov soviétique a été renommé « Oraşul Stalin » (La Ville de Staline) pendant les années 1950-1960, les autorités ont inscrit le nom de « Staline » sur les pentes de Tâmpa grâce à la plantation d’espèces d’arbres de couleurs différentes. La présence de cette signature en arbres était un fort symbole de la métamorphose radicale engendrée par des mutations politiques, socio- économiques et ethniques profondes de cette ville. Au fil des ans, la végétation régénéré a embrouillé la signature en arbres de Staline, comme un temps historique manipulé, progressivement éliminée par la Nature elle-même.
Toutefois, ce genre de ruines sur le mont Tâmpa reste vaguement visible aujourd’hui, en particulier les vestiges presque complètement détruits sur le sommet de la montagne. Je suis montée à pied jusqu’au sommet de cette montagne de seulement 960 mètres d’altitude pour chercher les traces historiques. La forêt touffue a rendu les sentiers sauvages, dangereux au point qu’on conseille souvent aux touristes et aux habitants de monter au sommet par télécabine, car les ours peuvent apparaître dans la forêt en croissant les promeneurs. La force de la Nature sauvage m’a tellement impressionnée, non seulement parce qu’elle efface les empreintes historiques, mais aussi parce qu’elle détache la notion de l’histoire chez les habitants locaux, pour eux, l’histoire de la signature en arbres de Staline semblait beaucoup moins intéressante dans leur quotidien que celles des ours descendant dans la ville.
Cette impression a atteint son niveau maximal quand je me suis trouvée au milieu des vestiges architecturaux au sommet du Tâmpa. L’état ruiné des ruines ne nous permet plus de la considérer comme véhicule rétrospectif dans la temporalité historique. Cet état témoigne justement de l’indifférence du cours de l’histoire des hommes au pied de la montagne. Seul un petit panneau installé parmi les ruines nous raconte l’histoire du lieu.
En ce lieu en ruine, il existait la forteresse de Brasovia. Avec le mont Tâmpa, la forteresse représentait l’un des plus anciens symboles de la communauté de Brașov. Depuis le XIIIe siècle, la forteresse a été construite sur la montagne et a été utilisée comme un refuge pendant les périodes difficiles par la population locale. Lorsqu’elle a été détruite au milieu du XVe siècle, la forteresse a perdu son importance stratégique et il ne reste aujourd’hui que des pierres parmi les herbes. Au sommet de la montagne se trouvait un bastion ovale ou octogonal, permettant aux défenseurs d’observer, de bonne heure, les mouvements des envahisseurs à Tara Barsei. Ce bastion a été démoli en 1455, avec les murs restants, et à sa place a été ensuite élevée une croix au XVIIe siècle, une chapelle en 1712 et une pyramide en 1849. Cette dernière était destinée à célébrer la confrérie des armes russo-autrichiennes.
J’ai ainsi compris la faible conception de l’histoire des habitants au pied du mont Tâmpa. Pour eux, chaque fois que les forces étrangères se confrontaient dans le pays, c’était toujours la plus forte qui— à une certaine période — construisait un monument en ce lieu symbolique. Dans la répétition de l’histoire, ces monuments étaient construits et détruits sans cesse, comme un cycle de construction — destruction — reconstruction du Temps historique. Ainsi, sur les ruines au sommet de Tâmpa s’accumule en réalité une multiple épaisseur du Temps historique. Devant ces vestiges des ruines, il nous semble aujourd’hui difficile de distinguer les couches différentes de l’histoire qui a eu lieu. L’absence quasi-totale des empreintes historiques nous a empêché de traverser les épaisseurs du Temps.
Ce qui reste vaguement visible parmi ces ruines est une dernière couche du Temps historique au tournant du XIXe et du XXe siècle. En 1896, à l’occasion de l’anniversaire du millénaire depuis la Conquête hongroise de la plaine de Pannonie, au sommet du mont Tâmpa a été élevée une statue dédiée à Árpád (ca. 845-ca. 907), le premier grand-prince des Magyars. Ce monument a demeuré peu de temps, étant détruit en 1916. Lors de mes enquêtes au sommet de Tâmpa, cette ruine se présentait sous la forme d’un socle rond au diamètre de 2,1 mètres ; avec les herbes qui poussaient dans les fissures, même cette dernière couche des ruines était méconnaissable.
J’ai eu ainsi l’idée de restaurer ces ruines, ou bien de sceller les ruines, en rajoutant une dernière couche de construction — un cadran qui recouvrirait cette dernière ruine. Cet acte de création était dès le début différent des constructions monumentales in situ : au lieu de conquérir la montagne symbolique, j’ai souhaité cosmiser cet espace profondément historicisé, par le retour au cycle du Temps cosmique.
Un jour de beau temps, avec les matériaux de cette création — du sable blanc —, je suis montée très tôt jusqu’à cette ruine avant que le premier rayon du Soleil n’arrive au sommet. J’ai érigé un gnomon au milieu du socle du dernier monument détruit, puis j’ai répandu une couche de sable sur le socle. J’attendis le premier rayon du Soleil, et lorsque la première ombre du gnomon apparût sur le bord de la ruine, j’ai commencé mon acte de création qui allait durer une bonne journée. Avec un doigt, j’ai tracé à intervalles réguliers le long de l’ombre sur le sable. Au moment où je traçais ces lignes, je voyais que cette dernière couche sur la ruine brillait harmonieusement avec la lumière changeante du ciel. De cette manière, j’ai tracé ces rayons cosmiques, l’un après l’autre, jusqu’au moment où l’ombre du gnomon atteignit l’autre bord du socle.
Sans regarder l’horloge, ou le temps linéaire qui nous emmène dans l’histoire, sans penser non plus aux couches du Temps historique qui se cachaient au-dessous du sable, je me suis référée seulement à la mesure perceptive des écarts des tracés. J’ai ainsi créé un champ d’énergie cosmique mais quotidienne, recouvrant comme une dernière couche du Temps, d’une temporalité cosmique. La ruine relève l’homme d’une « faillite intime qui le prédispose à éprouver devant toute œuvre en péril une sensibilité compatissante », devant les ruines, l’homme peut « se mettre à leur écoute et transmettre leur message critique. » L’acte de création sur de multiples couches des ruines au sommet du Tâmpa, est en fin du compte, un acte de « survivre à des ruines », dans un éternel retour à l’harmonie cosmique.